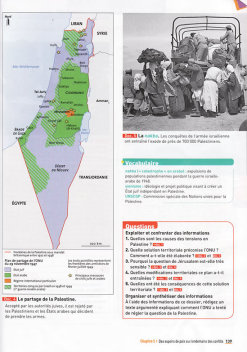Samuel F. Hart - Silvia Cattori
Entretien avec Samuel F. Hart, ambassadeur des États-Unis.

Samuel F. Hart, 77 ans, un ambassadeur états-unien à la retraite, était l’un parmi quelques trois cents participants à la « Flottille de la Liberté II » attendant à Athènes que le gouvernement grec l’autorise à appareiller pour Gaza. Humble et discret, le regard bleu intense, M. Hart a répondu aux questions de Silvia Cattori. Il a exprimé sans hésiter ce que tout politicien honnête, ou tout diplomate, devrait être capable d’exprimer, mais ne vous dit généralement pas.
Silvia Cattori :
Quand vous êtes arrivé à Athènes vous pensiez embarquer rapidement pour Gaza (1) Dix jours plus tard, les garde-côtes grecs n’ont toujours donné aucun signe qu’ils laisseraient les bateaux de la « Flottille de la Liberté II » quitter le port. Quel est votre sentiment ? Les organisateurs devraient-ils continuer d’essayer jusqu’à ce que le blocus illégitime et inhumain de Gaza soit levé ? Samuel F. Hart :
(2) On peut toujours espérer que quelque chose de positif arrive. Je suppose que, si cette flottille ne peut pas partir, il y aura une autre tentative similaire. Si oui, j’essaierais de la réaliser différemment - peut-être en choisissant un autre pays de départ. Je pense que les gens ne vont pas dire : « O
K, c’est comme ça, arrêtons ». Je pense qu’ils vont essayer à nouveau. Cela dépend tellement de ce qui peut se passer par ailleurs. Dire «
OK, les Israéliens ont gagné » et accepter cela comme une défaite finale serait imprudent. Je ne pense pas que les organisateurs vont dire cela.
Silvia Cattori : Lors de la précédente « Flottille de la Liberté I », neufs passagers turcs ont été tués et beaucoup d’autres ont été blessés par les soldats israéliens qui ont attaqué leur bateau Mavi Marmara. Le fait que les soldats israéliens pourraient le faire à nouveau ne vous effraye pas ?
Samuel F. Hart : Voyez, je suis un homme âgé. Que peuvent-ils me faire ? Si je suis en mesure de faire quelque chose, je dois me poser ces questions : si ce n’est moi, qui ? Si ce n’est maintenant, quand ? Ceux qui le peuvent ont l’obligation de se dresser contre l’oppression des plus faibles. Nous avons une obligation. Nous sommes tous des êtres humains. Quand vous voyez des gens opprimés et que vous pouvez les aider, vous avez l’obligation de le faire.
J’ai choisi d’être ici parce que je pense qu’il s’agit d’un problème important ; et que je suis en mesure d’y apporter mon aide.
Silvia Cattori : Le fait que vous soyez prêt à risquer votre vie pour exprimer votre solidarité avec les Palestiniens qui souffrent sous l’oppression israélienne est quelque chose de très impressionnant. Si vous ne réussissez pas, vous pourrez être fiers d’avoir essayé, quoi qu’il arrive...
Samuel F. Hart : Le danger n’est peut-être pas si grand. Mais, bien sûr, je suis prêt à prendre ce risque. Vous savez, il n’y a que de rares actions qui valent vraiment la peine d’être menées. Si vous voulez rendre le monde un peu meilleur, vous devez essayer d’apporter votre contribution à ce monde meilleur. Et si vous échouez, vous essayez encore. Essayer et échouer, c’est mieux que de ne pas essayer du tout. Tous ceux qui sont impliqués dans cette action peuvent être fiers de faire quelque chose pour les autres. Il y a beaucoup de manières de faire quelque chose pour les autres. Vous pouvez aider votre voisin, vous pouvez aider les malades, et vous pouvez aussi faire un don à la Croix Rouge. C’est aussi une noble manière. Cette action-ci a une signification particulière parce qu’elle implique de vous mettre vous-même en danger.
Silvia Cattori : Vous attendiez-vous à ce que la « Flottille de la Liberté II » soit confrontée à autant de problème, dès son début ?
Samuel F. Hart : Je ne dirais pas que je m’y attendais, mais je ne suis pas surpris. Je ne m’attendais pas à ce que les choses se passent sans aucun problème. Cependant, je pensais que nous réussirions à prendre la mer et à faire voile vers Gaza. Je pensais à la manière dont j’allais me comporter quand le moment de vérité viendrait face aux Israéliens. Je ne pensais pas à la manière dont j’allais me comporter vis-à-vis du gouvernement grec, ou vis-à-vis du gouvernement des États-Unis. Donc, c’est comme de partir pour combattre dans une guerre et de découvrir que vous vous trouvez dans une autre.
Je ne sais pas ce qui motive le gouvernement grec à se faire l’allié du gouvernement israélien dans cette affaire. Certains ont suggéré que c’est à cause des problèmes économiques et financiers de la Grèce. Et que les Israéliens auraient dit : « Si vous voulez que nous vous aidions, vous devez faire cela pour nous ». Je ne pense pas que les Israéliens aient ce genre de pouvoir ; mais les États-Unis d’Amérique l’ont. Je crois que la seule chose qui ait pu convaincre le gouvernement grec d’interdire le départ des bateaux est une intervention des États-Unis.
Ce qui me surprend, c’est la peur que les Israéliens ont de cette flottille. L’énergie qu’ils ont déployée et la pression politique qu’ils ont exercée sont incroyables. Je suis surpris qu’ils soient allés aussi loin pour tenter d’empêcher cette flottille. Si j’étais à la tête du gouvernement israélien, il y avait un moyen très simple pour faire face à cette flottille, mais il est totalement contraire à la nature du gouvernement israélien. Ce moyen pour Israël était de dire : « OK, laissons partir la flottille. Nous allons monter à bord des bateaux et nous allons les fouiller pour nous assurer qu’aucune arme ni aucun équipement à usage militaire ne se trouve à bord. Et ensuite allez-y, allez à Gaza, déchargez votre cargaison, nous n’interviendrons pas. » La presse internationale aurait complimenté les Israéliens s’ils avaient dit cela, et cela aurait été une histoire d’un jour.
Mais ce genre de comportement est au-delà de la capacité d’un gouvernement israélien. Les autorités israéliennes croient en général que l’autre côté ne comprend que la violence. La plupart des Israéliens le croient également : alors, si la violence ne fonctionne pas, comme cela est arrivé avec la « Flottille de la Liberté I », la fois suivante vous augmentez le niveau de violence. Cela est arrivé maintes et maintes fois.
Silvia Cattori : Du point de vue d’Israël, toutes ces « Flottilles » ne sont que des provocations !
Samuel F. Hart : J’en reviens au mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Beaucoup d’entre nous dans la délégation états-unienne disent : « Nous sommes ici pour les mêmes raisons pour lesquelles les militants de la liberté sont allés dans le sud des États-Unis au début des années 1960. Parce que nous voyons une injustice, nous voulons attirer sur elle l’attention du public. Nous ne voulons pas que l’on continue à faire silence sur cette injustice. Nous voulons lancer un débat public. Par conséquent, nous essayons de trouver un moyen d’amener les gens à en prendre conscience ; à ne pas les laisser confortablement dans leur ignorance. »
Cela est-il une provocation ? Cela dépend de ce que vous entendez par provocation. C’est un défi ; mais je n’appellerais pas cela une provocation. L’appeler une provocation implique que les participants à la flottille sont eux-mêmes responsables si quelque chose leur arrive ; c’est blâmer les victimes. C’est comme si je vous offrais un bouquet de fleurs et que vous me frappiez à la tête en prétendant que vous êtes innocente parce que j’aurais dû savoir que vous n’aimez pas les fleurs ; donc c’est de ma faute si vous m’avez frappé à la tête. En hébreu on appelle cela « chutzpah » [du culot]. Quelqu’un qui a de la « chutzpah » est quelqu’un qui, ayant tué père et mère, réclame la miséricorde de la Cour parce qu’il est orphelin. J’ai terriblement honte que mon gouvernement semble adopter cette attitude envers la flottille.
Silvia Cattori : Un certain nombre de journalistes et de citoyens suivent probablement cet évènement aux États-Unis. Si, finalement, la « Flottille de la Liberté II » ne peut pas prendre la mer, qu’allez-vous leur dire, de retour chez vous ?
Samuel F. Hart : Je m’attendais à pouvoir dire en rentrant : « Je suis monté sur ce bateau. Nous sommes partis pour Gaza. Quand la marine israélienne est arrivée, elle nous a tous arrêtés. Ils nous ont gardés en prison pendant quelques jours et finalement ils nous ont expulsés d’Israël en disant que nous ne pourrions pas y revenir pendant dix ans. » Après avoir raconté cette histoire, j’aurais ajouté que, comme nous avions pu attirer l’attention du monde pendant quelques minutes sur un sujet qui est le plus souvent ignoré, cela en avait valu la peine, quoiqu’il en ait coûté en termes de temps et d’argent.
Voila ce que j’espérais qu’il se passerait. Maintenant, si nous ne pouvons pas partir, je ne pourrai pas dire cela. Si nous ne pouvons pas partir, je devrai dire : « Nous voulions aller à Gaza. Nous avons essayé de le faire. Nous avons dû faire face à des problèmes qui ont rendu ce départ impossible en raison de l’action du gouvernement des États-Unis, du gouvernement israélien, et du gouvernement grec. Nous pensons que notre cause est juste. Nous pensons qu’elle mérite l’attention du monde. Elle a au moins obtenu quelques minutes dans les médias internationaux. Et nous reviendrons. »
Silvia Cattori : Pensez-vous que des erreurs ont été commises dans l’organisation de cette « Flottille de la Liberté » ?
Samuel F. Hart : Comme je ne participe pas aux réunions stratégiques, tout ce que je puis faire est d’observer les ombres sur le mur. Vous ne voyez jamais la réalité, vous en voyez seulement les ombres. Je pense que la nature même de cette organisation et les personnes impliquées conduisent à une certaine désorganisation. Si, par exemple, nous avions été capables de faire partir la flottille en mai, les choses auraient été plus faciles. Je ne dis pas que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement israélien n’auraient pas trouvé les moyens de créer des difficultés. Mais je pense que le fait que la flottille ait été retardée si longtemps - de mars, à mai, à juin, finalement à juillet - leur a donné beaucoup de temps pour trouver les moyens de rendre son départ, non pas impossible, mais beaucoup plus difficile.
Vous savez, quand vous avez affaire avec une vingtaine de pays, et de nombreuses organisations dont certaines sont concurrentes au sein de ces pays, tout cela diminue la force, la solidarité du mouvement, et rend les accords plus difficiles à trouver. Mais cela ne veut pas dire que nous n’aurions pas atteint exactement le même résultat. Je viens d’apprendre aujourd’hui qu’il y avait eu un sabotage sur les bateaux il y a une année. Je l’ignorais ; donc on aurait pu penser que l’on aurait essayé de trouver un moyen d’empêcher que cela ne se reproduise ; c’est, bien sûr, plus facile à dire qu’à faire. Les bateaux sont à l’eau. Vous trouvez un port mais vous n’avez pas le contrôle de la sécurité du port. Donc, il est difficile d’empêcher un sabotage de se produire si quelqu’un a la capacité d’attaquer certains des bateaux avec des hommes grenouilles.
C’est vraiment décevant de constater que, en ce moment, nous ne sommes pas vraiment unis. Je ne suis pas ici pour jeter la pierre à qui que ce soit. Je ne suis qu’un volontaire disant qu’il espérait que nous trouvions un moyen d’affronter les Israéliens ; l’objectif réel. Pas le gouvernement des États-Unis, pas le gouvernement grec, pas les uns les autres ; mais c’est difficile à faire.
Silvia Cattori : Avez-vous quelque chose à suggérer aux organisateurs de la « Flottille de la Liberté » qui doive être amélioré ?
Samuel F. Hart : Je pense que, s’il y avait un consultant en gestion pour examiner cette organisation, il recommanderait d’embaucher un planificateur qui soit à plein temps sur l’affaire. Cette personne collecterait toutes les informations et élaborerait un calendrier précisant ce que nous allons faire. Ainsi, toutes les personnes impliquées seraient prêtes à agir rapidement. Maintenant, je sais bien que, quand vous avez une organisation de bénévoles - et j’ai participé à un grand nombre d’entre elles - c’est difficile à faire. Mais, sans une très bonne gestion au sommet, les choses ne fonctionnent généralement pas très bien : il y a trop de voix discordantes, trop de cuisiniers autour de la marmite.
Silvia Cattori : Aujourd’hui, 4 juillet, jour de l’Indépendance des États-Unis, en qualité d’ambassadeur à la retraite, vous pourriez être accueilli à la luxueuse fête officielle à l’ambassade des États-Unis. Mais vous êtes ici, dans ce modeste hôtel trois étoiles, un parmi les centaines de participants motivés par le projet de briser le siège de Gaza. N’est-ce pas quelque chose d’inhabituel pour une personne de votre niveau, pour un ambassadeur !? Pensez-vous que les gens, aux États-Unis, peuvent comprendre et soutenir un tel engagement de la part d’un de leurs anciens représentants ?
Samuel F. Hart : Je ne me soucie pas de participer à des célébrations à l’ambassade des États-Unis. Je me souviens du premier discours du 4 juillet que j’ai donné comme ambassadeur. C’était au temps de l’administration Reagan. J’ai dit que, lorsque nous célébrons la Constitution et l’indépendance, nous parlons aussi parfois du patriotisme. Pour certains, le patriotisme signifie : « qu’il ait raison ou tort, c’est mon pays » ; quoi que fasse mon pays, je le soutiens. Mais pour moi ce n’est pas du patriotisme. Pour moi, le véritable patriotisme n’est pas de dire « qu’il ait raison ou tort, c’est mon pays ». C’est aider à faire une union plus parfaite. C’est soutenir les politiques que vous croyez justes et essayer de changer les politiques que vous croyez fausses. Je pense que c’est cela le vrai patriotisme. J’ajouterais que la grande majorité des gens, aux États-Unis, n’approuvent pas cette définition.
Silvia Cattori : Ils considéreraient que vous êtes à la mauvaise place, une sorte de traître à la politique de votre pays ?
Samuel F. Hart : Le fait qu’à un moment j’aie servi comme ambassadeur ne m’enlève pas mes droits de citoyen. Cela m’empêchait d’être ouvertement critique vis-à-vis des politiques du gouvernement des États-Unis quand j’occupais cette position. Mais aujourd’hui je peux faire tout ce que je veux. Je n’ai pas de limites pour donner mon avis.
J’aime à croire que nous avons le droit, aux États-Unis, d’être en désaccord avec les politiques du gouvernement sans être qualifié de traître ; néanmoins, certains verront les choses de cette façon.
Je me suis aussi opposé à la guerre en Irak. Alors que la guerre du Vietnam avait commencé depuis une année, je me trouvais en Indonésie et en Malaisie, tout près de l’endroit où la guerre se déroulait. Au début j’ai pensé que nous n’avions pas d’autre choix que de poursuivre cette guerre. Parce qu’à cette époque, la théorie qui avait cours était la théorie des dominos : si le Vietnam tombe, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et l’Indonésie vont suivre. Quand je suis rentré aux États-Unis, en 1964, et que j’ai vu le prix que les gens payaient pour le Vietnam, j’ai changé d’avis et je me suis opposé à la guerre parce que c’était une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, ou seulement à un prix que les États-uniens n’étaient pas disposés à payer ; aucun grand intérêt national n’était en jeu. J’ai dit qu’il était temps d’en sortir ; j’ai cessé d’être en faveur de la guerre et je suis devenu un opposant à la guerre.
J’ai toujours été opposé à la guerre en Irak, parce qu’elle était complètement stupide.
Silvia Cattori : À quel parti politique appartenez-vous ?
Samuel F. Hart : Je me suis toujours considéré comme indépendant. Mais à un certain moment dans ma vie, j’ai voté pour les Républicains libéraux. Puis la branche libérale du Parti républicain est morte. Je suis un progressiste dans le sens où beaucoup de libéraux républicains l’étaient. Je suis un conservateur dans le domaine fiscal et un libéral dans le domaine social. Aujourd’hui, je vote souvent pour les Démocrates.
Silvia Cattori : Ce n’est pas habituel de voir un ambassadeur aussi clairement engagé. Je pourrais difficilement trouver un tel exemple dans mon propre pays...
Samuel F. Hart : Aux États-Unis il y en a beaucoup. J’habite à Jacksonville, en Floride. C’est loin de Washington DC. Mais je reçois tous les jours des messages de gens qui sont à Washington. Je pense que si vous interrogiez en privé tous les diplomates de carrière qui ont servi comme ambassadeurs des États-Unis, la plupart d’entre eux seraient d’accord avec ce que j’ai à dire sur la question de la politique vis-à-vis d’Israël. Rares sont ceux qui pensent qu’elle a du sens. Elle est contraire à l’intérêt national des États-Unis. Dans de nombreuses ambassades, les diplomates ont une influence sur les décisions politiques. Mais en Israël, nos diplomates n’ont aucune influence sur la politique ; n’ont jamais eu voix au chapitre en ce qui concerne la politique. Cette affaire est traitée à la Maison Blanche et au Congrès. Comme il s’agit d’une chose à laquelle un simple individu ne peut rien changer, vous en arrivez à vous demander si votre désaccord avec la politique suivie est si important que vous deviez démissionner en signe de protestation. Eh bien, pratiquement personne ne démissionne. Après avoir fait connaître votre opinion par les canaux appropriés, si vous voulez poursuivre votre carrière de diplomate, vous vous tenez simplement à l’écart des domaines de profond désaccord et vous trouvez autre chose de valable à faire.
Silvia Cattori : Quand avez-vous commencé à vous préoccuper de l’oppression des Palestiniens ?
Samuel F. Hart : Dans les années 1977 à 1980, j’ai été en poste à l’ambassade des États-Unis à Tel-Aviv. À cette époque, j’étais le conseiller économique et commercial ; le numéro trois de l’ambassade. Je connaissais très bien la Cisjordanie et la Bande de Gaza. J’y ai passé beaucoup de temps et je parlais avec les gens. J’ai vu ce qui s’est passé à cette époque. J’ai vu le rôle qu’a joué mon gouvernement, non en étant la cause de ce qui s’est passé, mais en permettant que cela se passe. Nous n’avons pas dit aux Israéliens : non, vous ne pouvez pas coloniser la Cisjordanie ; non, vous ne pouvez pas punir collectivement la population de Gaza. À cette époque, l’accent n’était pas mis tellement sur Gaza, mais sur la Cisjordanie. La Cisjordanie était ce qui intéressait vraiment les Israéliens. Pour des raisons historiques, la Bande de Gaza n’a jamais fait partie du Grand Israël. Gaza a toujours été un territoire étranger à Israël.
Vous vous souvenez de l’histoire de Samson dans la Bible. Dalila était une étrangère, une Philistine de Gaza. Cela ne faisait pas partie d’Israël. Mais la Cisjordanie, que les Israéliens appellent Judée et Samarie, a fait partie à une époque d’un État israélien. Ce qui intéresse Israël dans les territoires palestiniens, c’est vraiment la Cisjordanie. Gaza est une chose secondaire. Parce que Gaza est palestinienne, elle est impliquée dans l’ensemble du problème. Mais si vous disiez aujourd’hui aux Israéliens : écoutez, vous pouvez prendre toute la Cisjordanie mais oubliez Gaza, ils concluraient l’affaire en une minute.
Lorsque j’étais en Israël, j’en suis venu à réaliser que le but à long terme des Israéliens était d’absorber l’ensemble de la Cisjordanie. Le cadre idéologique du parti Likoud, avec à l’époque Menahem Begin à sa tête, et des gouvernements ultérieurs du Likoud, a toujours été d’étendre les frontières d’Israël du Jourdain à la Méditerranée. La guerre de 1965 en a fait une possibilité réelle.
Silvia Cattori : Avez-vous rencontré Benjamin Netanyahou ?
Samuel F. Hart : Non. Quand j’étais en Israël Netanyahou était encore un jeune homme qui grimpait les échelons. Et il a été très précieux pour les Israéliens. Il est allé aux États-Unis alors qu’il était enfant et il est allé à l’école aux États-Unis. Je ne me souviens pas quelles ont été les circonstances exactes, mais il a vécu aux États-Unis, au moins comme adolescent. Et de ce fait, parce qu’il parle couramment l’anglais comme les Américains, il est très efficace lorsqu’il s’adresse à eux. Comme il parle comme un Américain, on ne dit pas : « Ah, c’est un étranger », comme on le dirait de quelqu’un qui a un accent israélien. Il peut dire les choses les plus scandaleuses et les plus destructrices de façon très calme et familière, et son bagout contribue à les faire paraître raisonnables. C’est un atout très important. Mais Netanyahou n’était pas au pouvoir à cette époque. C’étaient Begin et Shamir.
Silvia Cattori : Lorsque vous les avez rencontrés, quelle a été votre impression ?
Samuel F. Hart : J’ai vu Begin à de nombreuses reprises. J’ai eu une seule fois quelque chose à négocier avec lui, parce que, normalement, c’est la tâche de l’ambassadeur. Et à cette époque, j’étais conseiller. L’ambassade se trouve à Tel-Aviv et, bien sûr, tout le gouvernement israélien excepté le ministère de la Défense est à Jérusalem. Le ministère de la Défense est à Tel-Aviv. Un jour le bureau de Begin a appelé et a demandé à me parler ; j’ai naturellement accepté. J’ai appelé Washington pour les informer que j’étais appelé à Jérusalem pour rencontrer le Premier ministre. Je leur ai dit que je ne savais pas quel était le sujet, mais j’ai demandé s’il y avait quelque chose que Washington souhaitait que j’aborde avec lui. Je suis allé là-bas et aussi bien Moshe Dayan que Ezer Weismann étaient présents. J’ai plaisanté avec eux en disant que j’aurais dû prendre du renfort. Je ne savais pas que j’allais rencontrer tout à la fois le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et le Premier ministre. Que puis-je faire pour vous, ai-je demandé ? Ils avaient une requête et je leur ai dit : « Eh bien, je vais voir, je vais la transmettre à Washington et je reviendrai vous apporter la réponse. Et en passant, pendant que je suis ici, y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour mon pays ? » Il s’est avéré qu’un accord mutuellement bénéfique a pu être conclu. Quoi qu’il en soit, j’ai été amené à connaître Begin assez bien. Mais je me suis principalement occupé du domaine économique avec le ministre de l’Économie, le ministre des Transports et le directeur de la Banque centrale. Je n’ai jamais beaucoup parlé avec Itzhak Shamir.
C’était une époque, en 1977-80, où il y avait quelques progrès concernant la paix. C’était sous la présidence de Jimmy Carter, l’époque des Accords de Camp David et du Traité de paix avec l’Égypte. Le traité a représenté un grand avantage pour Israël parce que l’Égypte a été mise de côté en tant que seule force militaire crédible face à Israël. En retour, l’Égypte a récupéré la Péninsule du Sinaï. Mais le seul engagement que Jimmy Carter a réussi à obtenir de Menahem Begin sur le problème palestinien était qu’il pourrait y avoir quelques entretiens avec des « notables » palestiniens sur l’avenir de la Cisjordanie et de Gaza. L’OLP était exclue parce que, à cette époque, elle était encore considérée par Israël comme une organisation terroriste. Quiconque parlait avec Yasser Arafat était coupable d’un crime majeur. Il y avait un Israélien qui possédait un bateau appelé La Voix de la Paix. Son nom était Abie Nathan. Il avait un petit bateau avec des équipements de radiodiffusion au large des côtes israéliennes. Abie est allé voir Arafat, c’était peut-être au Maroc, et il a été accusé de soutenir l’ennemi. C’est ce qui arrivait à quiconque parlerait ou aurait le moindre contact avec l’OLP, cette « organisation terroriste ». Cela vous paraît-il familier aujourd’hui ?
Silvia Cattori : La plupart des gens, à cette époque, ne comprenaient pas ce qu’était Israël. Mais les dirigeants que nous connaissons aujourd’hui - Barak, Netanyahou, Sharon - nous avons appris à savoir avec quelle brutalité ils agissent. Les dirigeants que vous avez rencontrés à cette époque étaient-ils du même genre, aussi brutaux, aussi cruels ?
Samuel F. Hart : Un peu d’histoire au sujet de Begin. Sa préoccupation essentielle était de s’assurer que quelque chose comme l’holocauste ne se reproduise pas. Ce n’était pas seulement la préoccupation de Begin ; c’est quelque chose qui imprègne toute la psychologie de la population israélienne. Et on peut comprendre jusqu’à un certain point pourquoi. Mais lorsqu’il s’agit de Netanyahou ou de Sharon, la question devient : quels moyens utilisez-vous pour arriver à vos fins ?
Begin était le chef de l’Irgoun qui a capturé deux soldats britanniques à l’époque du mandat, les a exécutés, et les a pendus la tête en bas en piégeant leurs corps avec des explosifs en représailles contre les Britanniques pour avoir capturé des membres de l’Irgoun. Il avait donc du sang sur les mains.
Shamir était le chef du « gang Stern », qui a fait sauter l’Hôtel King David. Sharon a toujours été un soldat. Et son attitude envers les ennemis était : nous ne faisons pas de prisonniers, nous ne montrons aucune pitié. Ce n’était pas un mauvais soldat si vous l’aviez à vos côtés, mais personne ne l’aurait jamais appelé un humanitaire. Pour tous ces hommes, une vie israélienne innocente a toujours valu la vie d’une multitude, d’une infinité peut-être, de non-Israéliens innocents.
Est-ce que cela a toujours été ainsi ? Non. En fait avant eux, avant la montée du Likoud au pouvoir, il y avait des gens au sein du gouvernement, comme Moshe Sharett, qui avaient une opinion différente. Ils étaient prêts à accepter les frontières d’Israël comme elles étaient, et à essayer de développer une relation positive avec leurs voisins ; à être un membre pacifique du Moyen-Orient. Pour d’autres raisons, cela ne s’est pas produit. Les Arabes, à cette époque, n’y étaient pas prêts. Ils en étaient encore à essayer de renverser les résultats de la guerre de 1947-48. Ils pensaient encore qu’ils pourraient vaincre Israël. Ils n’étaient donc pas de bons partenaires pour la paix. Mais, après Sharett, de plus en plus nombreux ont été les membres de l’« establishment » politique israélien à accepter ce qui était essentiellement la vision du monde de Ben Gourion et certainement de Begin : « Israël est entouré d’ennemis, nous sommes constamment menacés d’anéantissement ; par conséquent, tout ce que nous faisons pour préserver notre existence est justifié. Par conséquent, la fin justifie les moyens. Par conséquent, nous ne sommes pas liés par des règles comme les Conventions de Genève ou les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ».
Israël a commencé l’escalade de la violence en partie en réponse à des attaques à petite échelle. Mais une fois que vous entrez dans un cycle de violence, vous ne savez jamais qui a commencé. Il ne s’agissait pas d’une guerre sainte puisqu’elle ne porte pas sur la religion - mais la spirale de la violence était violemment engagée à l’époque du Traité de paix avec l’Égypte. L’Égypte a obtenu quelque chose, Israël a beaucoup obtenu, et les Palestiniens n’ont rien obtenu. J’étais le représentant des États-Unis aux pourparlers, après Camp David, avec les soi-disant « notables » palestiniens, qui ont été autorisés à venir et à parler avec les Israéliens. Nous avons eu deux réunions. Lors de la première réunion, il est apparu très clairement que les Israéliens n’étaient pas prêts à faire quoi que ce soit. Ils voulaient un traité de paix avec l’Égypte et ils ont donc accepté d’avoir quelques discussions, mais elles étaient dès le début supposées arriver à l’échec. Et après la deuxième réunion, cela s’est terminé.
Silvia Cattori : Avez-vous compris à cette époque que les Israéliens ne rendraient jamais la moindre parcelle de terre aux Palestiniens ?
Samuel F. Hart : Je ne dis pas cela. Je dis que le gouvernement Netanyahou ne rendra jamais rien. Mais il y a eu un moment où cela a été près de se produire ; alors qu’Yitzhak Rabin était Premier ministre et qu’il a négocié de bonne foi avec l’OLP, et que les Accords d’Oslo ont suivi. Parce que Rabin jouissait d’une grande crédibilité dans l’opinion publique israélienne - on l’appelait Monsieur Sécurité - il a pris la décision de faire la paix et de renoncer à la terre. Il était prêt à le faire et ceux qui appartenaient à l’école de pensée de Netanyahou l’ont tué. Tout comme les Frères musulmans ont tué Sadate. C’est la récompense que vous obtenez quand vous êtes un pragmatique et un faiseur de paix dans cet environnement.
Silvia Cattori : Le rejet de l’injustice n’est généralement pas ce qui guide les autorités des États-Unis ; un pays qui mène des guerres dévastatrices qui ont provoqué depuis les années 1950 des millions de morts et détruit des pays entiers. Je persiste à dire qu’il n’est pas courant ici en Europe de voir un ambassadeur se joindre en toute humilité à l’action de simples citoyens pour appeler les instances internationales à cesser de couvrir les crimes d’Israël. Quel a été votre parcours ?
Samuel F. Hart : J’ai rejoint les services des affaires étrangères en partie parce que je pensais que je pourrais y faire quelque chose de positif ; en quelque sorte rendre le monde un peu meilleur. Pour aller plus loin, ce qui me dérange le plus n’est pas que les Israéliens fassent ce qu’ils font, mais que mon gouvernement et mes impôts les aident à le faire. Et c’est la raison pour laquelle je pense que, comme un homme qui en sait assez sur cette situation pour pouvoir en parler avec une certaine autorité, j’ai l’obligation de le faire ; c’est pourquoi je suis ici.
Silvia Cattori : Quand est-il devenu évident pour vous que votre gouvernement allait continuer de mener des guerres illégales contre de nombreux pays ; que la politique étrangère des États-Unis était catastrophique ?
Samuel F. Hart : Avant d’avoir été en Israël je n’ai jamais focalisé mon attention sur les Israéliens. Quand j’y étais, il y avait assez peu d’Américains qui n’étaient pas juifs à l’ambassade des États-Unis. Et il y en avait beaucoup qui étaient juifs. Et la meilleure façon de convaincre un Américain juif qu’Israël n’a pas toujours raison et ne mérite pas toujours le soutien des États-Unis est de l’envoyer à l’ambassade américaine à Tel-Aviv ; parce que vous y voyez tous les jours la duplicité, la méchanceté, la division du monde entre eux et nous. Et vous auriez pu penser qu’il y aurait une certaine réciprocité, quelque reconnaissance de la part des Israéliens qui reçoivent journellement du contribuable américain une part de ce qu’ils mangent et de ce qu’ils utilisent pour jouir de la vie. Vous auriez pu penser qu’il y aurait un peu plus de sensibilité à l’égard de ce que les États-Unis considèrent comme leur intérêt. Et vous voyez que ce n’est pas le cas.
Alors, pourquoi est-ce que cela continue ? C’est ici que vous entrez dans la politique intérieure états-unienne. Comme je l’ai souvent dit, si vous voulez trouver aux États-Unis trois questions qui sont clairement des questions de politique étrangère mais qui ne peuvent pas être traitées comme des questions de politique étrangère, la première est la politique envers Cuba, la deuxième est la politique de la drogue, et la troisième est la politique vis-à-vis d’Israël. Toutes sont des questions de politique intérieure qui sont déterminées de façon parallèle, non pas par les intérêts de politique étrangère des États-Unis, mais par des considérations de politique intérieure du président et des membres du Congrès. Et cela est vrai tant pour les Républicains que pour les Démocrates. Et cela ne va pas changer.
Silvia Cattori : Mais, à l’extérieur, il est difficile de comprendre pourquoi les gouvernements successifs des États-Unis laissent Tel-Aviv faire tout ce qu’il veut, y compris leur répondre de manière très arrogante.
Samuel F. Hart : J’ai posé une fois cette question à un membre du Congrès qui était en visite en Israël. Je lui ai dit : dites-moi pourquoi chaque année quand nous recevons la demande d’aide israélienne et que j’ai passé en revue chaque ligne et écrit un rapport (et j’en sais peut-être plus que quiconque sur ce sujet) qui généralement recommande certaines réductions, lorsque ce rapport arrive à Washington vous maintenez le montant ou même vous l’augmentez. Pourquoi cela ? Il m’a répondu : si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas le système politique des États-Unis. Si vous êtes un membre du Congrès ou un président ou n’importe quel fonctionnaire élu, et que vous voulez être réélu, vous regardez qui va travailler pour vous et qui va travailler contre vous.
Silvia Cattori : L’argent, l’argent...
Samuel F. Hart : Il ne s’agit pas seulement d’argent. Et il ne s’agit pas seulement de la composante juive du lobby pro-israélien américain. Il est probable qu’en nombre, la composante protestante évangélique du lobby pro-israélien est plus importante - les églises fondamentalistes. C’est un très curieux partenariat. Mais ils viennent et ils disent à quelqu’un au Congrès : si vous votez avec nous sur les questions liées à Israël, si vous vous faites le défenseur d’Israël, nous allons vous soutenir avec de l’argent, en convainquant les électeurs, et en exprimant des vues positives à votre sujet. Sur la plupart des questions il existe deux côtés, mais sur la question israélienne il n’y a pas de deuxième côté. Les Palestiniens n’ont pas de voix crédible. Les politiciens vont avec les Israéliens parce que, si vous ne le faites pas - et il y en a eu qui ne l’ont pas fait - ils vont travailler aussi dur qu’ils le peuvent pour vous battre. Et ils y arrivent souvent.
Interview réalisée à Athènes le 4 juillet 2011.
Silvia Cattori
[1] M. Hart a été invité à participer à la Flottille par le "Free Palestine Movement" (à ne pas confondre avec l’association concurrente "Free Gaza” qui l’a superbement ignoré).
[2] L’ambassadeur Samuel Hart a été soldat, diplomate et enseignant. Il est diplômé de l’Université du Mississippi, de la Fletcher School of Law and Diplomacy, et de l’Université Vanderbilt. Il a également suivi la JFK School of Government à Harvard. Comme soldat il a été parachutiste et aide d’un général. Il a été libéré avec le grade de capitaine. Pendant 27 ans Samuel Hart a été diplomate de carrière au Département d’État des États-Unis. Ses affectations ont principalement été en Amérique latine (Chili, Uruguay, Costa Rica, et Équateur), mais elles ont aussi inclus le Moyen-Orient (Israël) et l’Asie (Indonésie et Malaisie). De 1980 à 1982 il a été en poste à Washington en tant que directeur des relations des États-Unis avec le Venezuela, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bolivie. Au cours de sa carrière au Département d’État, Samuel Hart a reçu de nombreuses récompenses pour services exceptionnels. Cela a conduit à sa nomination comme ambassadeur en Équateur en 1982.
Depuis sa retraite, Samuel Hart est resté actif comme consultant en affaires et comme conférencier sur des questions de politique étrangère dans de nombreux collèges et universités en tant que Woodrow Wilson Visiting Fellow. Au cours des 15 dernières années, il a également été un conférencier très populaire sur des navires de croisière, principalement sur des questions de politique étrangère des États-Unis. En 1994, Samuel et son épouse, Jo Ann, ont déménagé à Jacksonville, en Florida, où ils ont été tous deux actifs au sein du World Affairs Council et dans d’autres activités bénévoles.