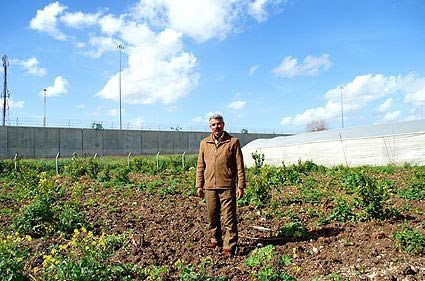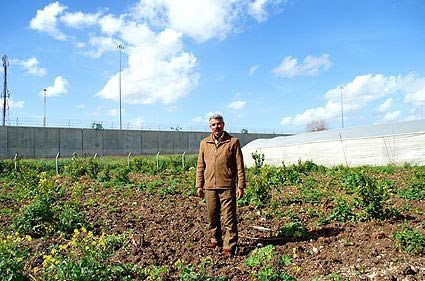
- Fayez Taneeb,
agriculteur palestinien de Tulkarem en Cisjordanie, prisonnier sur sa
terre entre le mur et les usines de pesticides de l’occupant, il résiste
par son acharnement à cultiver ses terres dans des situations
extrêmement difficiles : terres spoliées, destruction des cultures par
les colons, restrictions d’accès aux champs...(Ism-France)
Dans ce dossier politique, l’auteure invitée Vivien Sansour et le
directeur du programme Al-Shabaka Alaa Tartir donnent la parole à un
certain nombre d’agriculteurs qui essaient actuellement de résister à
ces défis. Ils ont travaillé en particulier avec des agriculteurs de
Jénine et de Jéricho, où deux zones industrielles sont en construction,
et ils proposent des mesures pour aider les agriculteurs à se
réapproprier leur souveraineté et à rester sur leurs terres. (1)
Les Zones Industrielles Palestiniennes : la nouvelle menace
« Un jour nous nous sommes éveillés à l’annonce du gouverneur de
Jénine que nous devions enlever nos cultures de la terre. Si nous ne le
faisions pas volontairement, eux allaient le faire pour nous. J’avais du
blé à ce moment-là. Je suis descendu et je l’ai moissonné afin qu’il ne
soit pas détruit. »(2)
Ainsi parle Mahmoud Abufarha, l’un des nombreux agriculteurs du
village de Al-Jalameh dans le district de Jénine, dans le nord de la
Cisjordanie occupée, qui lutte pour rester sur sa terre. Aujourd’hui,
des agriculteurs comme Abufarha sont non seulement menacés par
l’implacable politique israélienne de confiscation de terres, mais de
plus en plus il sont confrontés à des confiscations de terres par l’AP
elle-même. Elle veut y construire des zones industrielles qui,
prétend-elle, vont aider les agriculteurs et créer des emplois. Mais
beaucoup d’agriculteurs craignent que ces zones ne soient uniquement
destinées à faire d’eux des travailleurs prolétarisés plutôt que des
fermiers productifs et à les priver délibérément de leur source de
pouvoir la plus précieuse - la terre - tout en prétendant les aider.
Les efforts pour réduire le pouvoir des agriculteurs palestiniens ne
sont pas nouveaux. En réalité, de multiples tentatives et politiques
agressives pour éliminer pratiquement les agriculteurs palestiniens sont
en cours depuis le début de l’état d’Israël en 1948, lorsque ces
efforts pour « moderniser » les fermiers commencèrent à introduire de
nouvelles méthodes et de nouvelles semences, qui réduisaient leur
indépendance et donnaient la priorité à la quantité sur la qualité, afin
de pourvoir aux besoins du nouveau projet sioniste.
Tandis qu’Israël faisait son auto-promotion partout dans le monde
comme le pays qui avait « fait fleurir le désert », les agriculteurs
palestiniens étaient manipulés et instrumentalisés pour des expériences
qui leur ont coûté de nombreuses souches de leurs semences indigènes
ainsi que de grands pans de leurs terres productives. Après qu’Israël
eut occupé les territoires palestiniens en 1967, il appliqua beaucoup de
ces méthodes à la Cisjordanie. Depuis sa création en 1993, l’AP a
poursuivi ce processus au lieu de l’inverser, abandonnant des
agriculteurs palestiniens qui sont aujourd’hui dans une situation
terrible.
Avec la
tendance mondiale à industrialiser les terres agricoles,
les agriculteurs de Palestine ne sont pas un cas unique : partout dans
le monde, les producteurs subissent des tentatives pour réduire leur
autonomie en matière de production de nourriture et pour accroître leur
dépendance vis-à-vis des banques, des multinationales et des géants de
l’agrobizness. Que ce soit à Haïti, au Honduras, en Inde ou en
Palestine, l’agriculture paysanne à échelle familiale représente la
dernière frontière de résistance contre un système politique mondial
actionné par le capital, qui dilue les identités des gens et les prive
de leur souveraineté alimentaire dans le but d’assurer à une oligarchie
la domination politique et économique sur les ressources tant humaines
que naturelles.
Pour Abufarha comme pour beaucoup d’agriculteurs, l’agriculture n’est
pas seulement une source de revenus, c’est l’exemple vivant d’une
relation intime avec la terre, et elle est profondément imbriquée avec
l’identité, les croyances et les valeurs. Dans le cas de la Palestine,
elle est aussi le moteur qui anime les luttes paysannes pour
l’autodétermination face à la colonisation israélienne de leurs terres.
Ce secteur, longtemps négligé et souvent saboté par les dirigeants
palestiniens, les institutions internationales et Israël, se voit
confronté à une nouvelle menace : la création de
zones industrielles palestiniennes,
subventionnées au niveau régional ou international. Ces zones
contribuent à priver l’économie palestinienne de son potentiel de
transformation ; elles étendent la domination territoriale israélienne
dans les Territoires Palestiniens occupés (TPO) ; elles augmentent la
dépendance des Palestiniens vis-à-vis d’Israël sur le marché des biens
et de l’emploi ; et elles supplantent la petite agriculture familiale,
qui est une force de soutien du peuple palestinien depuis des
générations. Mais l’AP, son secteur privé captif et ses sponsors
internationaux sont d’un autre avis : pour eux, les zones industrielles
sont un pilier de l’effort de construction d’un état qui va renforcer
l’économie palestinienne et réussir un développement durable.
L’agriculture sous une occupation et un néolibéralisme invasif
Les agriculteurs palestiniens affrontent aussi d’autres contraintes.
Depuis 1967, par exemple, Israël a noyé le secteur agricole sous les
pesticides, herbicides, insecticides et fertilisants chimiques. Dans la
même veine, il a défendu un système de monocultures qui a laissé les
paysans plus vulnérables devant des intermédiaires qui dictent les prix
et imposent les variétés culturales. Il a également poussé le secteur
agricole vers des cultures très exigeantes en temps de travail, comme
les fraises, les cornichons ou les tomates, qui sont produites en serre à
grand renfort de pesticides, moyennant des forces de travail faiblement
rémunérées. (3)
Par ailleurs, le Ministère palestinien de l’ Agriculture n’a jamais
été capable de protéger les agriculteurs d’un déversement de produits de
l’agrobizness en provenance de colonies juives, qui inondent les
marchés locaux de Palestine.
La prohibition officielle des denrées coloniales n’a
pas été introduite avant 2010, mais souvent elle n’est pas appliquée et
les produits continuent d’arriver des fermes israéliennes industrielles,
même quand les produits saisonniers locaux sont disponibles.
En juin dernier encore, le Ministre de l’ Agriculture de l’AP, qui
avait d’abord encouragé les agriculteurs à produire des pastèques en
promettant promotion et protection des cultures, a été obligé
d’autoriser sur le marché palestinien des arrivages massifs de pastèques
produites à moindre coût en Israël – des arrivages sous la protection
de l’armée israélienne. A présent ce genre de chose se produit tous les
jours, conséquence de l’asymétrie entre Palestiniens et Israéliens, et
entraîne des pertes économiques importantes pour les producteurs
palestiniens.
Comme beaucoup l’ont relevé, les fonds dévolus au secteur agricole
n’ont pas franchi la barre du 1 % du budget annuel total de l’AP. En
même temps le secteur agricole ne comptait que pour 1,4 % de l’aide
internationale totale entre 1994 et 2000, et aujourd’hui ce chiffre est
tombé à 0,7 %. Pour 2012, l’agriculture n’a fait que 5,9 % du PIB
palestinien alors qu’elle représentait 13,3 % en 1994. Et tout cela
malgré les rapports du Programme Alimentaire Mondial (PAM) selon
lesquels 50 % des ménages palestiniens souffrent actuellement de
l’insécurité alimentaire.
La dernière session des pourparlers de « paix » parrainés par les USA
entre l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)/AP et Israël
indique que de futures abominations attendent le paysan palestinien. En
mai 2013, le Secrétaire d’État John Kerry a promu
l’Initiative Economique Palestinienne (PEI)
au Forum Economique Mondial en Jordanie, promettant « un nouveau modèle
de développement » qui réunirait 4 milliards de dollars
d’investissements internationaux et en retour, accroîtrait le PIB
palestinien de quelque 50 % en trois ans, réduirait le chômage et ferait
augmenter les salaires. (Quelques mois plus tard le chiffre de 4
milliards de dollars était ajusté à 11 milliards de dollars).
Des fuites précoces de la PEI ont suscité des vagues de critiques de
la part de l’approche du développement néolibérale traditionnelle à
hiérarchie descendante, celle qui est vénérée dans les instituions
financières internationales. En fait, tout ceci ne diffère guère du
modèle économique raté que les décideurs internationaux ont imposé aux
palestiniens depuis le début du processus d’Oslo, lequel propose des
solutions économiques pour des problèmes politiques.
Dans la PEI, l’agriculture est un des huit « secteurs clés » choisis
pour le développement, principalement via les nouvelles « zones
économiques spéciales » (SEZ) palestiniennes, c’est-à-dire des zones
industrielles censées relancer l’économie et le secteur agricole en
particulier via des investissements de l’agrobizness et des profits plus
importants. Déjà, deux parcs industriels sont en construction à Jénine
et à Jéricho. Ils ont obtenu des fonds internationaux et sont contrôlés
par une institution affiliée à l’AP, Palestinian Industrial Estates et
par la Free Zone Authority (PIEFZA). (4)
Cependant, malgré les allégations que ces zones industrielles
constituent un projet national palestinien, des publications ont alerté
sur les bénéfices qu’en tireront les entreprises israéliennes, en
particulier des compagnies basées dans des colonies juives en
Cisjordanie, illégales en droit international – tout en démembrant les
familles paysannes et les bandes de terre les plus fertiles des TPO. Les
critiques ont décrit ces zones comme des
« prisons économiques »,
rendant les Palestiniens encore plus asservis à Israël, vu que l’AP
doit compter sur la bonne volonté de l’occupant pour l’accès, la
mobilité et le transfert des revenus des taxes.
En outre, concentrer l’activité dans ces zones sape la propriété
foncière des Palestiniens en les enlevant à leurs terres pour les faire
travailler dans des zones spécifiques, en général près des centres
urbains, sans parler de la rupture de relations entre le consommateur et
le producteur local. Cela entraînera inévitablement un transfert de
population et une urbanisation forcée des communautés rurales à long
terme. Les conséquences seront des préjudices graves pour la
souveraineté et le développement durable palestiniens, sans parler des
dégâts environnementaux qu’on peut prévoir de la production de déchets
industriels, tant dans les zones agricoles que résidentielles.
Pour défendre sa collaboration avec Israël, l’AP a fait beaucoup
d’efforts pour promouvoir les zones industrielles comme si elles étaient
des projets de développement anodins. En juillet 2013, le Premier
Ministre intérimaire Rami Hamdallah posait devant les caméras sur le
site de la Zone Industrielle de Jénine et déclarait que la zone créerait
plus de 15.000 emplois. Ce même mois, le Ministre palestinien du Plan
rencontrait des ministres japonais, jordaniens et israéliens pour
discuter du développement du Parc Industriel agricole de Jéricho (JAIP),
une zone décrite comme un projet pilote de
« l’Initiative du corridor pour la paix et la prospérité » que le Japon a proposée dans l’objectif d’une coopération régionale. (5)

- Un agriculteur
palestinien récolte ses figues de Barbarie dans son champ à Arabouneh
près de Jénine en Cisjordanie, le 18 juillet 2011 - AP Photo/Mohammed
Ballas
A qui profite le système ? Pas aux agriculteurs de Jénine !
Toutefois les agriculteurs palestiniens doutent qu’ils profiteront de
ces zones industrielles. Naturellement, les plus fortes tensions
existent avec les petits fermiers qui n’ont pas été consultés et voient
das ces zones une menace existentielle. En fait, beaucoup de petites
exploitations ont déjà été abandonnées parce qu’elle ne peuvent
concurrencer les produits de l’agrobizness venant d’Israël et de ses
colonies illégales. Les zones industrielles ne feront qu’aggraver le
problème.
La Zone Industrielle de Jénine, connue aussi sous le nom du village
d’Al-Jalameh, est issue du processus d’Oslo et elle était prévue pour la
fin des années ’90 avec le soutien de la Banque Allemande de
Développement (KfW). En 2000, l’AP expropria 933 dunams (93 ha) au total
pour « usage public » et les transféra à la PIEFZA. Mais après la
Deuxième Intifada qui commença en 2000, le projet fut gelé. C’est
seulement en 2007 que PIEFZA l’a ranimé accordant la concession à un
partenaire turc, OBB-BIS Industrial Parks Development and Management
Company, pour gérer le parc pendant 49 ans. Le fait le plus alarmant à
propos de la ZIJ c’est qu’elle est construite sur un sol qui fait partie
de la municipalité de la vallée de Jezraël (Marj ben Amer), la plaine
[d’Esdraelon] la plus fertile de Palestine, et qui fait partie du
Croissant Fertile. Historiquement, c’est le grenier à blé de la
Palestine.
D’après les agriculteurs locaux, le terroir sur lequel la zone
industrielle est maintenant construite a été appelée El-Roba’yat pendant
des générations. Les habitants des villages voisins de Al-Jalameh et
Burqin cultivent cette partie de la vallée de Jezraël et en tirent leur
subsistance. Le paysage est multicolore selon la variété des cultures,
comme l’épinard vert, les pousses de sésame ou le blé d’or. Beaucoup de
gens dans les villages et les villes des environs achètent leurs légumes
et leur fourrage sur ce site où les usines du parc industriel et la
centrale électrique vont être construites et étendues.
Pour construire cette zone industrielle, l’AP a exproprié les
producteurs de El-Roba’yat sous le prétexte du droit de préemption.
Cette loi permet au gouvernement d’acheter des terres
à des prix très bas censés compenser l’expropriation pour le « bien public ».
Mais certains fermiers refusent de renoncer à leur moyens de
subsistance pour la création d’une zone industrielle qui mettra fin à
leur mode de vie et détruira leurs ressources naturelles et économiques.
Une vingtaine d’agriculteurs ont récemment intenté une action en
justice contre l’AP contestant l’allégation que le terroir servira au
bien public.
Mahmoud Abufarha est l’un des agriculteurs qui se sont joints au
combat légal pour tenter de sauver sa terre. Parcourant la vallée dans
sa vieille Subaru il raconte comment sa famille a acquis cette terre :
« Nous avons économisé sur notre pain quotidien pour pouvoir payer cette
propriété. J’ai 59 ans et je cultive cette terre depuis un
demi-siècle. C’est ma vie ». Au bord des larmes, il contemple le site en
construction où des barrières métalliques et des structures en béton
sont en train d’être érigées à la place de ses champs d’orge et de blé.
Comme beaucoup de villageois, Abufarha croit que les décisions
politiques et économiques qui sont prises ne respectent ni son héritage
ni ses moyens de subsistance. « Les autorités disent que ce projet vise à
servir le bien public. Moi je produis de la nourriture. N’est-ce pas
davantage au bénéfice du public qu’une zone industrielle qui ne sert que
de grosses usines ? On dirait que nos vies sont un gros gâteau et que
l’AP, Israël et les donateurs veulent tous une part du gâteau sans
prendre en considération ce qui va nous arriver. Il s’agit uniquement de
profit, pas du bien public ».
Abufarha souligne qu’il y a d’autres moyens de déterminer la valeur
de la terre. « Mille deux cents dunums [120 ha], cela nourrit plus de
20.000 personne par an, mas maintenant nous devrons attendre notre pain
arrive d’autres régions. La terre c’est la vie. Sans nos terres nous
n’avons pas de vie ».
Malgré les efforts concertés pour sauver la vallée de Marj Ben Amer
de sa destruction annoncée, le tribunal a rejeté l’action intentée par
les fermiers contre l’AP. En avril 2014, les agriculteurs se sont vu
remettre des documents les forçant à accepter une compensation pour
leurs terres, qu’ils avaient refusé de vendre. Les filiales de l’AP ont
évalué les terres, et les prix ont été fixés sans aucune négociation
avec les propriétaires fonciers. Selon Abufarha : « On m’a dit : que je
veuille vendre ou pas n’a plus d’importance, la terre est à présent la
propriété de la zone industrielle. J’ai aussi été avisé que l’argent
serait déposé sur mon compte à titre de compensation, que je veuille le
prendre ou pas ».
Khaled Mireh, chef du Conseil du village de Al-Jamaleh, explique que
puisque les agriculteurs ont échoué à empêcher l’établissement de la
zone, le conseil du village s’efforce de minimiser les dégâts autant que
possible. La crainte de voir des déchets toxiques enfouis dans ce qui
reste de leurs terres est leur principal souci. « Il est inexplicable
qu’une zone industrielle soit construite sur des terres cultivées dans
une zone peuplée. Tout ce projet a été imposé à notre communauté et
maintenant nous devons en gérer les conséquences prévisibles, surtout
celles qui touchent à l’environnement et à la santé publique ».
Désignant une colline rocheuse à l’horizon, Mireh ajoute : « Nous ne
sommes pas contre le développement. Mais si nous avions voulu construire
une zone industrielle, nous aurions choisi cette colline, qui est loin
des habitats et qui est stérile ». A la question de savoir quelles
alternatives il aurait suggérées s’il avait été consulté, il dit : « Je
pense que la majorité des gens dans le village aurait salué un projet
impliqué dans ce que nous avons déjà. Un projet qui amènerait de petites
entreprises pour commercialiser les produits des fermiers ou mettrait
en valeur les choses que nous faisons tout en veillant au bien-être des
gens et à l’avenir de notre village ».
Sans hésitation, il affirme : « Nous avons en Palestine beaucoup
d’alternatives qui existent déjà. S’ils étaient intéressés par la
création d’emplois, ils auraient investi de manière à consolider les
nombreuses coopératives de fermiers et de producteurs, ce qui aurait
préservé la terre et l’environnement et aurait garanti la création
d’emplois locaux pour des gens d’ici, servant non seulement à notre
village mais à toute la Palestine » (
exemple )

- Un agriculteur
du village de Qaryut inspecte ses oliviers vandalisés dans la nuit par
des colons israéliens, le 9 octobre 2012. En 2013, les colons ont
détruit plus de 4.000 oliviers en Cisjordanie occupée
De Jénine à Jéricho
Alors que la Zone Industrielle de Jénine en est toujours à ses
débuts, l’infrastructure du Parc agro-industriel de Jéricho (JAIP) est
presque achevée. Des amas de métal d’une des usines déjà opérationnelles
jouxtent les panneaux solaires financés par l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA) pour fournir une énergie verte au
Parc. Subhi Hallaq, un ingénieur représentant la Compagnie d’électricité
du District de Jérusalem note cependant que l’électricité générée par
ces panneaux ne suffira pas, ce qui veut dire que de l’électricité
complémentaire devra être amenée d’Israël et de Jordanie. Entre-temps,
les habitants de Jéricho continuer à subir régulièrement des coupures de
courant.
JICA a été critiquée pour avoir produit des études de faisabilité
inadéquates et pour gérer le JAIP sans mécanismes de responsabilisation
ni mesures de transparence. Mais la principale critique est que le
succès du JAIP ne dépend pas seulement de la collaboration entre
colonisateurs et colonisés, mais que le Parc lui-même se situe dans la
fertile Vallée du Jourdain qu’Israël veut contrôler dans tout futur état
palestinien. Vu le vif intérêt d’Israël pour cette zone, beaucoup de
terres agricoles adjacentes sont contrôlées par des colonies juives,
dont on peut penser qu’elles seront les premières bénéficiaires du Parc
industriel, plutôt que les agriculteurs palestiniens.
Assis à l’angle de ce qui était naguère une ferme de maraîchage très
productive, l’agronome et propriétaire de pépinière Abou Muhanad
al-Fatyani explique comment les règles et les conditions du JAIP rendent
impossible une participation des agriculteurs. « Certaines personnes
affiliées à l’AP nous ont dit qu’elles pouvaient nous accorder des baux
pour utiliser notre propriété au sein de la zone industrielle. Mais le
bail proposé est de 30 $ le mètre, ce qui veut dire 30.000$ l’an par
dunum. Il n’y a pas un seul agriculteur qui peut offrir autant. Même si
les agriculteurs mettaient leur argent en commun pour ouvrir une usine,
ce ne serait pas faisable. Seuls de gros investisseurs ont les moyens
pour de tels contrats ».
Qui seront ces investisseurs, la question reste posée, de même que le
genre d’usines qui seront basées dans cette zone. Cette ambiguïté
exacerbe les préoccupations des petits fermiers de Jéricho tels que Abed
Alqader. Il explique que les agriculteurs sont pleins d’appréhension
"parce qu’ils ont de bonnes raisons de croire que ces zones
industrielles ne sont pas conçues pour produire quoi que ce soit. Ou
plutôt,
elle serviront d’installations de conditionnement pour les produits de l’agrobizzness des colonies.
Si ces zones étaient destinées à nous aider, nous les agriculteurs
palestiniens, pourquoi n’avons-nous pas été invités à aucune des
discussions ? » Abed Alqader demande : « Nos fermes sont des
exploitations familiales. Elles ne peuvent supporter des opérations
industrielles aussi massives, et nous n’avons pas été approchés pour
augmenter notre production ou pour acquérir de nouvelles compétences,
alors, comment peuvent-ils dire que ceci est une zone agro-industrielle
destinée à aider le fermier palestinien ? ».
A 1 km du JAIP s’étendent les champs de Nasser Ismaïl. En tant
qu’agriculteur biologique, Ismaïl est fier d’utiliser de l’eau propre
pour irriguer ses palmiers dattiers. Tout en entassant le fumier bio
pour que ses fils le répartissent équitablement à chaque arbre, Ismaïl
dit : « Nous sommes concurrencés par un flot de dattes des colonies, qui
sont produites avec des eaux usées non retraitées et qui sont beaucoup
moins chères ». Quand on lui dit que la zone industrielle voisine va
ouvrir des installations de conditionnement de dattes et d’autres
produits, il est choqué et dit : « Si cela est vrai alors c’est la fin
pour nous. Ces installations de conditionnement ciblent une production
de masse de cultures industrielles. Je suis un petit fermier ; Cela va
me faire perdre mon exploitation ».
Plus que tout autre sans doute, Ismaïl sait ce que veut dire lutter
pour maintenir la tête hors de l’eau. La signature des Accords d’Oslo et
du Protocole Economique de Paris ont introduit des réglementations qui
interdisent aux Palestiniens de vendre leur production à Israël.
Résultat : Nasser a perdu 84.000 ILS [shekels][soit près de 25.000$].
C’est alors qu’il a cessé de cultiver des figues et du raisin et qu’il a
commencé la culture des dattes comme culture de rente. Affrontant un
nouveau défi et davantage d’incertitudes à cause de la zone industrielle
voisine, Ismail dit qu’il n’aura peut-être pas la force de continuer
s’il perd sa ferme. Son frère Abou Issa , par contre, est déterminé à
continuer la culture malgré tous les obstacles : « L’amour de la terre
et de l’agriculture c’est comme un virus dans le sang : il reste
toujours là. Même si je ne plante qu’un pot de persil, il faut que je
produise de la nourriture. Et même si je perds, je ne quitterai jamais
la terre ».

- Les agriculteurs palestiniens sont le dernier bastion de la résistance
Un appel à la société civile
Depuis 2011, Israël a donné à certains agriculteurs de Cisjordanie et
de Gaza des permis pour aller assister à son plus grand congrès
agricole annuel, qui rassemble cultivateurs, acheteurs, distributeurs,
exportateurs, chaînes de marketing et autres pour travailler en réseau
et conclure des affaires. Ces mêmes individus qui étaient naguère
considérés comme « menaces à la sécurité » de l’état d’Israël sont
maintenant des hôtes d’honneur à un événement important à Tel Aviv. Les
invitations étendues à ces fermiers, dont les visites sont financées
par USAID, apparaissent comme une autre tentative de cooptation émanant
de l’Initiative Économique du Secrétaire d’État Kerry, dans le but de
persuader le petits agriculteurs palestiniens d’acheter selon les
critères de l’agrobizness. Si cela s’avère, cela va sans doute créer
davantage d’endettement et achever de déconnecter des agriculteurs
palestiniens de leurs terres.
Les agriculteurs palestiniens ont besoin d’avocats solides pour
défendre leurs droits contre les politiques d’Israël tout autant que de "
l’Etat " de Palestine. En tant qu’acteurs locaux ayant l’accès le plus
direct aux organisations et aux donateurs internationaux qui influencent
le développement de la politique en Palestine, les membres de la
société civile et des ONG portent une responsabilité spéciale pour agir
et défendre les agriculteurs palestiniens, en s’unissant autour du
travail que font déjà des organisations telles que le Syndicat des
comités de travail agricole (
UAWC), le
Centre Bisan pour la Recherche et le Développement et l’initiative
Sharaka (« Partenariat »)
Plus spécifiquement, la société civile et les ONG doivent aider à :

assurer soutien et ressources pour que les agriculteurs puissent durcir leur lutte pour résister aux zones industrielles.

ouvrir
des voies aux fermiers pour qu’ils puissent se confronter directement à
l’AP, y compris au système judiciaire de l’AP, qui dénient leurs droits
à ces fermiers.

développer
des projets en coordination avec des dirigeants communautaires pour
soutenir les agriculteurs, grâce à des structures alternatives
permettant une plus grande production, un marketing local et des réseaux
de valorisation locale.

organiser
une campagne de communication publique pour exposer le mythe du projet
de construction d’État, lequel est au service d’un ordre du jour
néolibéral aux dépens de l’agriculture palestinienne.
Le peuple palestinien ne peut attendre que la politique change. Il faut des efforts organisés et durables de la communauté pour
réinvestir dans l’agriculture locale.
Un objectif majeur serait de reconnecter les consommateurs avec les
producteurs en circuit direct. Cela nécessite un financement
communautaire d’entreprises et de projets agricoles – ce que pourraient
faciliter des structures coopératives – et des start-up marchandes ou
non marchandes qui puissent élaborer des outils rendant l’agriculture
durable plus accessible et plus réalisable pour les agriculteurs, les
revendeurs et les consommateurs.
Conclusion
Les agriculteurs sont l’ultime frontière de liberté des Palestiniens
et un pilier capital pour créer un modèle de développement alternatif
basé sur une économie de résistance et de ténacité (soumoud).
L’agriculture et la souveraineté alimentaire sont deux sources de
pouvoir qui permettent aux gens de réclamer leurs droits et de préserver
leur héritage ancien et divers. Privés des moyens de se nourrir, les
Palestiniens perdraient l’un des éléments de résistance les plus
importants dont ils disposent.
Notes :
(1) Merci aux agriculteurs, à Thaer Washaha (Centre Bisan) et à Rena Zuabi pour leurs précieuses contributions.
(2) Les citations proviennent des interviews réalisées par les auteurs.
(3)
Pour toute information, voir George Kurzom : Towards Alternative
Self-Reliant Agricultural Development (Birzeit : Birzeit University
Development Studies Programme, 2001) ; le MA’AN Development Center ainsi
que l’ UAWC (Union of Agricultural Work Committees).
(4) Pour une analyse en profondeur, voir : “Neoliberal Palestine” dans :
Ali Abunimah,
The Battle for Justice in Palestine (Chicago, Illinois : Haymarket
Books, 2014), 75-124, ainsi que les publications du Bisan Centre for
Research and Development.
(5) Le ministre japonais a avancé :
“Quand le concept de Corridor pour la Paix et la Prospérité » sera
matérialisé, le problème régional sera résolu par des voies économiques,
plutôt que par des voies sécuritaires ou politiques ».

*
Vivien Sansour née à Beit Jala est écrivain,
photographe, productrice et elle milite pour une agriculture de
résistance (Honduras, Inde, Uruguay, Palestine, Colombie, USA). Pendant 6
ans elle a travaillé sur le terrain avec des agriculteurs, collectant
leur histoire pour les transmettre. Elle est actuellement doctorante au
College of Agriculture and Life Sciences à la North Carolina State
University. Voir son interview en
vidéo.

*
Alaa Tartir coordonne le programme de Al-Shabaka
(The Palestinian Policy Network), il est chercheur doctorant au
Département ’Développement International’ de la London School of
Economics and Political Science (LSE). Il est également chercheur au MAS
(Palestine Economic Policy Research Institute) et au Centre Bisan pour
la Recherche et le Développement ainsi qu’au PARC (Palestinian American
Research Center) et au Centre pour le Moyen-Orient de la LSE. Il a
publié notamment "Le rôle de l’aide internationale dans le
développement : le cas de la Palestine 1994-2008" (Lambert 2011). Voir
son interview en
vidéo.